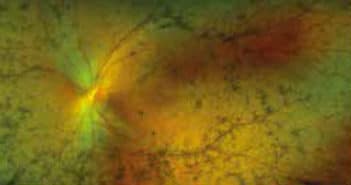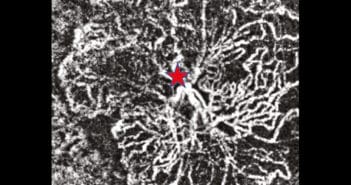Kératites infectieuses
Les kératites infectieuses bactériennes, mycotiques et amibiennes sont un motif fréquent de consultations aux urgences. Leur nombre est en constante augmentation ces dernières années, avec une croissance préoccupante des abcès d’origine mycotique. Elles représentent une des principales causes de cécité unilatérale dans le monde à cause des cicatrices cornéennes qu’elles induisent.
Le port de lentilles de contact souples est la principale cause d’abcès de cornée, avec une prédominance des abcès bactériens et notamment à Pseudomonas aeruginosa. Le diagnostic microbiologique reste difficile, bien que l’amélioration des techniques d’analyse permette une identification du germe en cause dans plus de 60 % des cas.
Un traitement doit être débuté en urgence, initialement orienté par la clinique, et doit être réévalué en cas de mauvaise évolution ou selon les résultats des prélèvements. Une hospitalisation reste nécessaire en cas de signes de gravité.