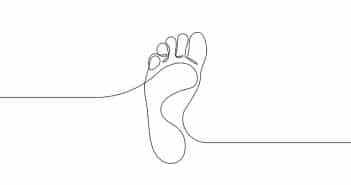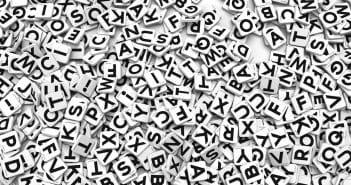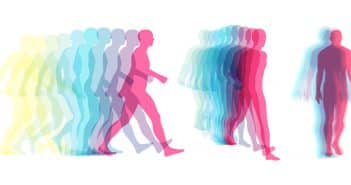L’imagerie oculaire du diabète : vers une meilleure précision clinique
L’imagerie rétinienne chez le patient diabétique permet, au travers des rétinographies en couleur et de la tomographie en cohérence optique, de diagnostiquer une rétinopathie diabétique accompagnée, ou non, d’un œdème maculaire diabétique et d’en connaître la sévérité, dans la plupart des cas. D’autres examens d’imagerie peuvent compléter de façon non systématique ce bilan de base et il est important d’en connaître les indications. Il s’agit soit d’examens non invasifs, tels que l’angiographie en cohérence optique (OCTA), ou d’examens avec injection de colorants, tels que l’angiographie à la fluorescéine ou au vert d’indocyanine, qui permettent d’obtenir des données pronostiques ou de poser des indications thérapeutiques. Enfin, l’imagerie étant en plein essor, de nouvelles modalités se développent telles que le couplage de l’OCTA avec l’optique adaptative, l’OCTA ultra grand champ, ou le doppler holographique, qui apporteront sans doute de nouvelles perspectives.