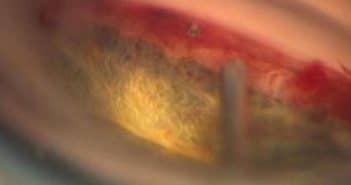Les lentilles journalières multifocales
Les lentilles de contact sont actuellement le moyen le plus utilisé et le plus sûr, pour corriger la presbytie autrement qu’avec des lunettes. Les statistiques internationales annuelles montrent, une fois encore, une progression des lentilles multifocales au détriment de la monovision, même dans les pays anglo-saxons encore très attachés à la monovision. En Italie, au Portugal et en France, le ratio multifocales/monovision est de l’ordre de 85/3 et le ratio mondial [1] (sur 33 pays et 20 000 adaptations) est de 42/8. De 2011 à 2016, le pourcentage d’adaptation en lentilles multifocales souples est passé, sur le marché mondial, de 11 à 19 %. Il existe donc une réelle dynamique sans doute liée à la sortie de plusieurs lentilles multifocales journalières.