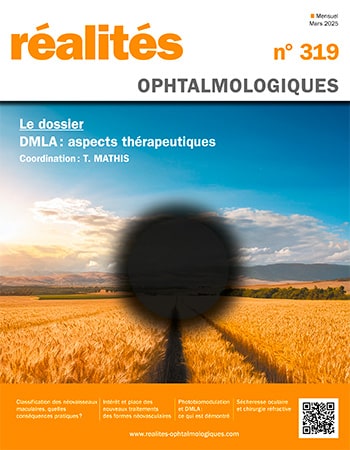Optimiser la détection des néovaisseaux maculaires de la DMLA en OCT-A
L’OCT-A a apporté une dimension fonctionnelle dans la prise en charge de la DMLA, permettant de mieux visualiser l’architecture néovasculaire et de détecter les complications au stade le plus précoce, avant même les premiers signes d’exsudation. L’OCT-A n’étant qu’un prolongement de l’OCT, il convient d’analyser simultanément toutes ses composantes, à savoir le B-scan, l’OCT-A superposée sur le B-scan et l’OCT “en face” pour une analyse optimale. Elle s’est donc imposée comme un biomarqueur additionnel à l’OCT structurelle dans la DMLA.