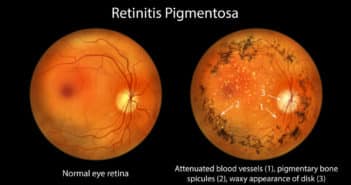Controverse – Faut-il utiliser la décaline pendant la chirurgie avant l’échange fluide-air ?
Alors que la chirurgie du décollement de rétine (DR) simple semble bien maîtrisée depuis l’apparition de la vitrectomie trois voies dans les années 1990, un sujet divise encore les chirurgiens : faut-il utiliser la décaline (Perfluorocarbone liquide ou PFCL) pendant la chirurgie avant l’échange fluide-air ?
Si son utilisation dans les cas complexes associés à la prolifération vitréorétinienne avant mise en place de silicone ne fait pas débat, dans les DR simples, macula on, on/off ou off, la question n’est pas tranchée. Nombre de chirurgiens l’utilisent systématiquement, d’autres pratiquement jamais.
Nous avons décidé de traiter ce débat par une controverse, le Pr David Gaucher montrera dans une première partie en quoi le PFCL est inutile, voire néfaste dans la chirurgie du DR simple. Dans une deuxième partie, le Dr Alban Comet expliquera pourquoi continuer à l’utiliser, de façon raisonnée. Les arguments des deux parties pourront servir au lecteur pour se forger son opinion sur le sujet !