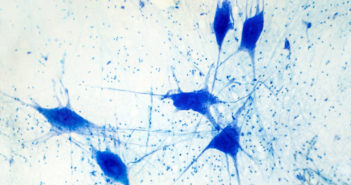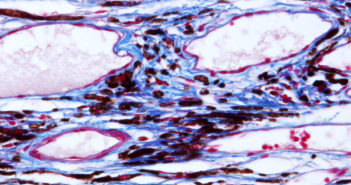Au cours de la dernière décennie, l’ophtalmologie a bénéficié du développement exponentiel des modalités d’imagerie en haute résolution. Leur caractère non invasif, rapide et reproductible permet de les classer comme des examens de routine clinique.
Ces examens d’imagerie sont principalement utilisés dans le dépistage, le diagnostic et le suivi des pathologies oculaires. Mais à l’aube de l’automatisation de la médecine, les travaux évaluant leur rôle potentiel dans l’identification des biomarqueurs de maladies systémiques, notamment des maladies cardiovasculaires, en font des outils prometteurs dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la recherche clinique.
Dans cette revue, nous tentons de mettre en lumière l’intérêt de l’intelligence artificielle et notamment du deep learning dans l’évaluation du risque cardiovasculaire à partir d’imageries rétiniennes.