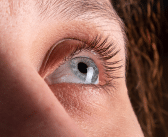DMLA : l’intérêt d’un test quantitatif de sensibilité aux contrastes
L’étude publiée en novembre par cette équipe de Boston visait à corréler les résultats d’un test fonctionnel, la sensibilité aux contrastes (qCSF), avec l’imagerie, i.e. les marqueurs OCT d’évolutivité de la DMLA intermédiaire.
Pour mémoire, le terme américain de “DMLA intermédiaire” correspond à une maculopathie liée à l’âge à un stade critique, comportant des drusen séreux (> 125 µm) et/ou des migrations pigmentaires maculaires [1]. Les résultats de l’étude suggèrent que la qCSF peut être corrélée avec le risque de progression de la DMLA intermédiaire vers l’atrophie géographique ou la DMLA néovasculaire.

Microbiote et DMLA : un lien plus que complexe
La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est la première cause de déficience visuelle chez les patients de plus de 65 ans et la prévalence devrait augmenter d’ici 2040. Son évolution peut mener à une forme atrophique ou néovasculaire. Des études récentes suggèrent un lien entre le microbiote intestinal et la DMLA via un axe intestin-rétine, où un déséquilibre du microbiote (dysbiose) favorise l’inflammation et la progression de la maladie.
L’alimentation modifie le microbiote et joue également un rôle clé dans la DMLA. En effet, un régime méditerranéen pourrait réduire les risques, tandis qu’un régime obésogène les accroît. Des nutriments comme les omégas 3 et les antioxydants influencent aussi le microbiote et pourraient protéger contre la DMLA.
Enfin, des études montrent des différences dans la composition bactérienne des patients atteints, ainsi que des polymorphismes génétiques, notamment du facteur H du complément, qui sont liés à la DMLA et au microbiote.
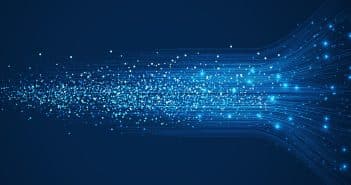
Trou maculaire du myope fort : particularités
Le trou maculaire (TM) est une complication fréquente de la myopie pathologique, pouvant évoluer vers un décollement de rétine (DR) et compromettre le pronostic visuel. Sa physiopathologie est multifactorielle, impliquant tractions vitréo-rétiniennes et contraintes mécaniques liées au staphylome postérieur.
La baisse d’acuité visuelle est variable et n’est pas toujours ressentie au stade initial du TM. L’indication opératoire repose avant tout sur la gêne fonctionnelle rapportée par le patient, en tenant compte des risques évolutifs et des lésions associées. La chirurgie, particulièrement délicate chez le myope fort, a pu bénéficier des progrès récents de l’imagerie et de l’instrumentation. Le pronostic est globalement moins bon que celui de l’emmétrope.
Les techniques de volet inversé de membrane limitante interne ont permis d’améliorer le taux de fermeture, en particulier dans les situations à risque d’échec (longueur axiale > 30 mm, présence d’un staphylome, DR associé). La récupération visuelle demeure souvent limitée par la fréquence des complications et des lésions associées.

Défis et promesses de l’intelligence artificielle en ophtalmologie
L’intelligence artificielle (IA) transforme progressivement l’ophtalmologie. Son intégration dans notre pratique médicale et chirurgicale s’améliore de jour en jour. Pourquoi s’adapte-t-elle si bien à l’ophtalmologie ? Quelle utilisation faisons-nous du deep learning et des grands modèles de langage (LLM) ? L’IA ne se limite plus à l’assistance, elle apprend, elle s’adapte, elle anticipe. Jusqu’où ira-t-elle ?
En assemblée plénière des Journées de réflexions ophtalmologiques (JRO) 2025, qui ont eu lieu les 21 et 22 mars derniers, plusieurs experts nous font part de leur expérience sur le sujet. Le Dr Assouline présente une plateforme robotisée capable d’automatiser la collecte et l’analyse multimodale des données. Le Dr Tahiri détaille l’impact de l’IA sur la chirurgie de la cataracte, allant du dépistage à la chirurgie robotisée. Le Pr Renard commente les progrès de l’IA dans le diagnostic et le suivi du glaucome. Enfin, le Pr Milea nous expose ses travaux qui combinent neuro-ophtalmologie et IA.

La macula bombée : physiologie et prise en charge
Initialement décrite chez les patients myopes forts, la macula bombée correspond à un bombement de l’aire maculaire vers l’intérieur du globe oculaire. Sa description s’étend aujourd’hui aux patients hypermétropes et emmétropes, ainsi qu’aux enfants et aux jeunes adultes.
Il existe de nombreux types de maculas bombées. Ceux-ci se différencient notamment par la hauteur du bombement maculaire, qui semble modifier le pronostic évolutif à long terme.
L’origine de la macula bombée est discutée. Il pourrait s’agir d’une poussée vers l’avant de l’aire maculaire, sous l’effet d’un remodelage scléral, notamment de la partie interne de la sclère, ou bien d’un affaissement choroïdien et scléral aux bordures du bombement responsable d’un bombement de l’aire maculaire restée en place.
Les patients atteints de macula bombée encourent un risque de décollement séreux rétinien élevé, de l’ordre de 50 %. Toutefois, son retentissement visuel limité et sa prise en charge mal codifiée autorisent souvent une surveillance simple.
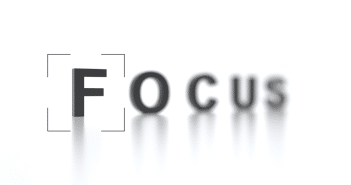
Mécanismes de progression myopique et freination
Face à l’épidémie silencieuse de myopie actuelle, la recherche ophtalmologique a profondément évolué. Notre compréhension des mécanismes sous-jacents, notamment le rôle du défocus rétinien périphérique, a ouvert la voie à de nouvelles stratégies de freination myopique efficaces. Ce nouvel arsenal thérapeutique, allant des mesures optiques aux collyres pharmacologiques en passant par l’éducation des familles, redéfinit notre rôle en tant qu’ophtalmologistes, passant de la simple correction à une gestion proactive de l’apparition et de la progression de la myopie. Il est donc fondamental de prévenir, diagnostiquer et traiter la myopie dès le plus jeune âge, afin de réduire l’ampleur finale de la myopie et, par conséquent, les risques de complications oculaires associés à la myopie forte à l’âge adulte.

L’apport de l’intelligence artificielle dans l’adaptation des lentilles rigides des patients atteints de kératocône
Il est reconnu que les lentilles de contact rigides perméables au gaz (LRPG) améliorent significativement l’acuité et la qualité visuelle des patients atteints de kératocône modéré à sévère. Elles permettent ainsi une amélioration de la qualité de vie [1]. L’adaptation en LRPG peut s’avérer longue et complexe, aussi bien pour le contactologue que pour le patient. L’augmentation de la fréquence du dépistage de cette maladie entraîne une augmentation de la demande d’adaptation en contactologie.
L’évolution des géométries et des matériaux des lentilles de contact rigides pour les patients atteints de kératocône permet l’adaptation de la plupart de ceux-ci [2]. Du succès ou de l’échec de cette adaptation découlera le reste de la prise en charge du patient. Une prise en charge chirurgicale, par anneaux intracornéens ou une greffe de cornée, pourra être proposée selon le stade de la maladie en cas d’échec d’une adaptation en lentilles.
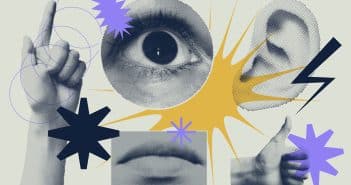
Interaction entre système visuel et oral : rôle de la proprioception
Par l’intermédiaire du nerf trijumeau, Ve paire de nerfs crâniens, l’appareil visuel et l’appareil buccal partagent des informations communes. Il existe en effet une relation neurologique étroite entre l’appareil buccal (branches maxillaire et mandibulaire) et l’appareil visuel (branche ophtalmique) grâce aux afférences trigéminales communes de ces deux organes.
Nos recherches cliniques ont montré que les fonctions visuelles, telles que la perception de la localisation spatiale ainsi que la disparition des pseudo scotomes visuels perceptifs, peuvent être modifiées. L’appareil buccal semble donc être un élément important, essentiel, dans le traitement des sujets dyslexiques ainsi que dans de nombreuses fonctions liées aux troubles cognitifs ou moteurs. Ceci, entre autres, remet en cause les traitements oraux, notamment orthodontiques, en raison de la création d’une dysperception orale iatrogène.

Maculopathie myopique tractionnelle : comment la traiter ?
La maculopathie myopique tractionnelle regroupe les atteintes chirurgicales spécifiques à la myopie pathologique. Plus fréquemment observées au-delà de 28 mm de longueur axiale, elles sont fréquemment associées à la présence d’un staphylome maculaire étroit ou large. La variété des formes cliniques n’a pas encore permis d’aboutir à un consensus sur sa prise en charge. Néanmoins, l’indication opératoire est aujourd’hui plus précoce, afin de prévenir l’apparition de formes anatomiquement très évoluées. Il faudra apprécier les autres atteintes de la myopie pathologique pour une prise en charge personnalisée du patient.

Néovaisseaux du myope fort et rupture de la membrane de Bruch : ressemblances et différences
La myopie forte (≥ –6 D ou longueur axiale > 26 mm) est en augmentation, surtout en Asie, et expose à des complications rétiniennes majeures. Deux d’entre elles sont capitales : la rupture de la membrane de Bruch et les néovaisseaux myopiques. Les ruptures, parfois inaugurales et silencieuses, constituent un marqueur de myopie dégénérative et un facteur de risque de néovascularisation ultérieure. Elles se détectent par OCT, angiographie ou fond d’œil, et peuvent être associées à des hémorragies, rendant le diagnostic différentiel difficile. Les néovaisseaux myopiques, le plus souvent rétro- ou juxtafovéolaires, entraînent une baisse visuelle et répondent généralement bien aux anti-VEGF, mais avec un risque de récidives. Le suivi attentif, associant OCT et angiographie, est crucial pour distinguer cicatrice, récidive ou nouvelle localisation. À long terme, l’association récidives, ruptures et atrophie choriorétinienne concourt à l’installation de la maculopathie myopique, d’où l’importance d’un diagnostic précis et d’une prise en charge rapide.
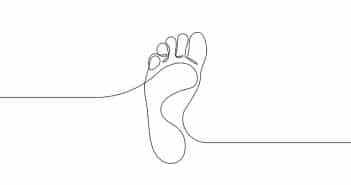
Le podologue dans la prise en charge du syndrome de dysfonction proprioceptive
Le rôle du podologue dans la prise en charge du syndrome de dysfonction proprioceptive est exposé dans chacun des trois domaines d’évaluation clinique de ce syndrome : le contrôle moteur (nocturne et diurne), la localisation spatiale, l’intégration multisensorielle (perception). Dans chacun de ces trois domaines, il est proposé un raisonnement sur l’action du podologue dans la prise en charge pluridisciplinaire des patients présentant un syndrome de dysfonction proprioceptive. Cette approche est identique pour les trois formes de ce syndrome et la thérapeutique proposée sera ajustée spécifiquement selon la forme de syndrome de dysfonction proprioceptive. Cette présentation est appuyée sur la littérature fondamentale et clinique, et le partage de l’expérience en pratique clinique.