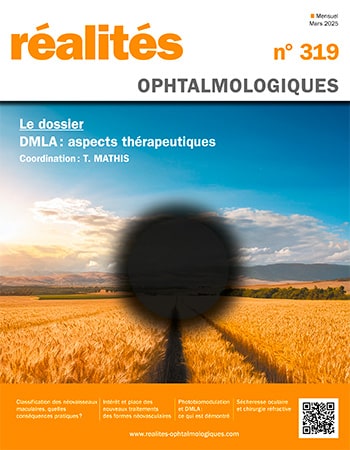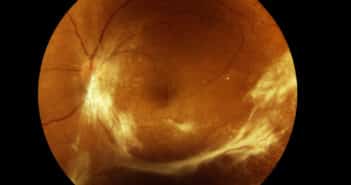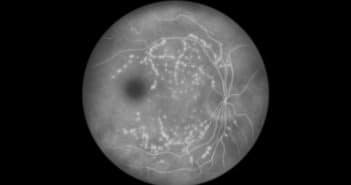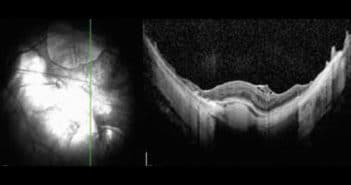Chirurgie lenticulaire pour l’hypermétropie : la prochaine étape ?
La chirurgie lenticulaire au femtoseconde, qui s’appuie sur le recours à un seul laser pour le remodelage cornéen, a vu le jour en 2007 et par son principe a conquis la communauté ophtalmologique. Cependant, force est de constater que son implantation à cette heure demeure une niche, et ce en dépit de l’explosion que cette technique a connue en s’implantant récemment en Asie et aux États-Unis. Explosion qui lui a permis d’atteindre 6 millions de procédures réalisées dans le monde en 2021, soit 25 % de la chirurgie réfractive cornéenne [1-6].
Les principales limites à évoquer sont les suivantes : portage exclusif jusqu’alors par le laboratoire Zeiss, qui l’a baptisée SMILE (pour SMall Incision Lenticule Extraction), et limitation à la correction de la myopie avec astigmatisme modéré en l’absence de cyclo-compensation. Ces obstacles sont désormais contournés grâce à l’arrivée de plateformes concurrentes positionnant désormais cette chirurgie lenticulaire comme un concept et non plus comme un produit. De plus, les avancées technologiques permettent d’intégrer des stratégies de centrage et d’alignement optimisées autorisant le traitement cylindrique.
Que penser de l’approche de l’hypermétropie, qui devrait renforcer la place de la technique ? Nous proposons ici d’aborder sa stratégie, ses limites et ses perspectives.