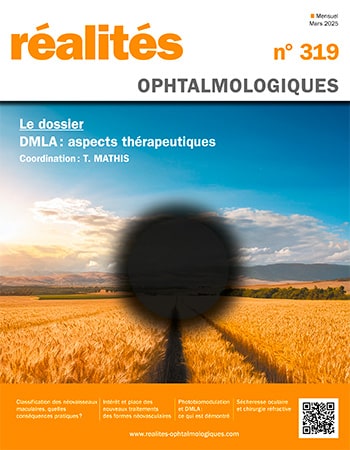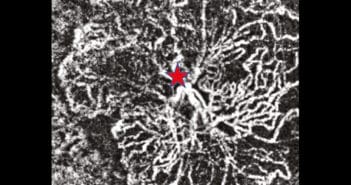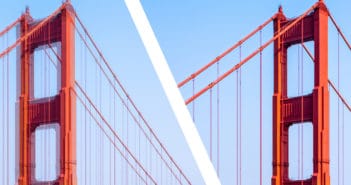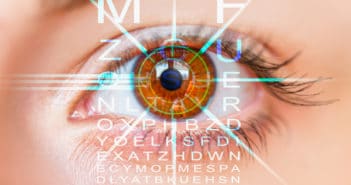
Glaucome après greffe de cornée
Le glaucome est une complication fréquente après kératoplastie. Il existe un lien étroit et réciproque entre hypertonie et greffe de cornée : l’hypertonie est un facteur de risque de kératoplastie et la kératoplastie est un facteur de risque d’hypertonie. Une vigilance particulière pour toute greffe de cornée doit donc être portée au dépistage d’une pathologie glaucomateuse en préopératoire et au suivi rigoureux de la pression intraoculaire en postopératoire.
La prise en charge diagnostique et thérapeutique d’un glaucome après greffe est difficile mais doit être précoce, rapide et adaptée. L’objectif est double : préserver la transparence du greffon et l’intégrité
du nerf optique.