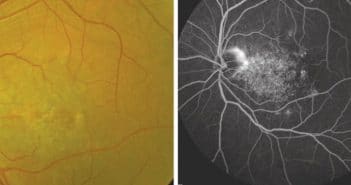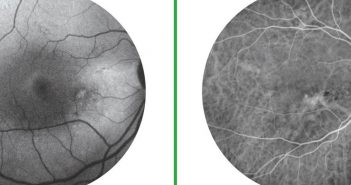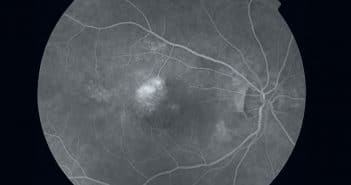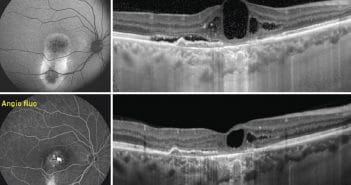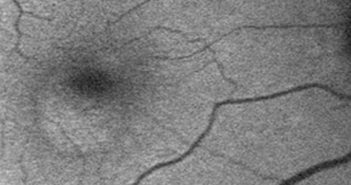Cinq questions capitales pour la prise en charge de l’œdème maculaire diabétique
La prise en charge de l’œdème maculaire diabétique (OMD) s’est enrichie ces derniers mois de plusieurs options thérapeutiques. Différents traitements injectables sont disponibles, différentes stratégies de traitement sont à notre disposition, et le traitement par laser continue à avoir dans certains cas une réelle légitimité. Un certain nombre de questions vont donc se poser à nous face à un patient diabétique : quel traitement de première intention prescrire, quand switcher, quand faut-il faire du laser, faut-il attendre avant de traiter, est-il justifié d’injecter intensivement au cours des premiers mois ?
Cet article se propose d’apporter des éléments de réponse à ces interrogations en s’appuyant sur les données récentes de la littérature, sur les recommandations de la Fédération France Macula et sur les enseignements tirés de notre pratique clinique.